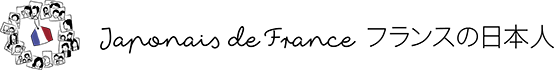Eri Maruyama 丸山依里
21 mars 2021
Fumie Kawabe 川辺文栄
10 avril 2021Je mélange les techniques traditionnelles de maroquinerie avec d’autres typiquement japonaises comme la broderie sashiko et l’ise katagami.
Mon prénom, c’est Naoko. Omori est mon nom de famille.
En japonais, Omori signifie grande forêt.
La famille de mon père habitait près du Mont Fuji, à proximité de la célèbre forêt d’Aokigahara, c’est probablement l’origine de mon nom. Voilà ce qui m’a inspirée quand j’ai créé ma marque de maroquinerie ATELIER OMORI et son logo.
Je n’ai jamais habité cette région car je suis née et j’ai grandi en banlieue de Tokyo.
Mes parents sont maintenant à Yokohama, une ville très connue pour son port et son ouverture sur le monde.
Enfant, j’ai vécu quelques années au Caire, pour le travail de mon père. Même en vivant au sein de la communauté locale japonaise, c’était bien différent du Japon.
À mon retour, j’avais onze ans, je ne me sentais plus à l’aise dans mon pays.
Mon histoire avec la France a commencé pendant mes études. J’avais visité le pays enfant, quand nous habitions en Égypte, mais j’en garde peu de souvenirs.
À l’université, j’ai étudié la chrétienté, je crois que cela n’existe pas en France. Je voulais faire mon mémoire sur le travail du grand historien des religions Mircea Eliade.
À la fin de ma troisième année, j’ai fait un voyage en Europe avec un de mes professeurs, spécialiste du premier art chrétien espagnol. Nous avons visité l’Espagne, l’Italie, la France, et l’Angleterre. J’ai découvert l’art roman, j’ai été fascinée par les églises du Sud de la France. Voilà comment j’ai changé mon sujet de mémoire, qui a finalement porté sur l’église Saint-Trophime d’Arles.

Dans la foulée, j’ai eu la chance d’obtenir une bourse pour faire mon année de maîtrise en France, à Toulouse. J’ai été diplômée en 2002. A cette époque, les masters 1 et 2 n’existaient pas.
Je suis repartie au Japon pour poursuivre mes études avec une thèse sur l’histoire de l’art.
Je voulais faire de la recherche, donner des cours dans une université, mais les postes d’enseignants se font rares au Japon. Il y moins d’étudiants à cause de la natalité qui baisse, et en plus, le gouvernement ne considère pas l’histoire de l’art comme importante. Beaucoup d’universités régionales ont fermé leur département des sciences humaines.
J’ai finalement trouvé du travail dans une petite maison d’édition, tout en continuant mes recherches.
J’avais très envie de revenir en France, et heureusement, pour mon doctorat, il me fallait y retourner.
Et un jour à Paris, j’ai rencontré celui qui allait devenir mon mari.
Il aime beaucoup le Japon, il est architecte et artiste. D’ailleurs, lors de notre première conversation, nous avons parlé de Sōetsu Yanagi, un écrivain penseur qui a écrit sur les artistes européens et les arts populaires du Japon.
Je vis à Paris depuis 2009. Comme mon mari ne parle pas japonais, c’était plus simple de rester en France.
Je ne maîtrisais pas suffisamment le français pour enseigner ici, j’ai trouvé un boulot où je prenais en charge des touristes japonais dès leur arrivée à Paris, et j’assurais la logistique de leur séjour.

Une fois ma thèse terminée, en 2012, j’ai voulu un travail plus stable, alors j’ai réfléchi à ce que je pouvais faire. Depuis toujours, j’adore l’artisanat, le travail manuel. Quand j’étais au lycée, je peignais et je dessinais beaucoup.
J’ai voulu apprendre la restauration d’art, mais les études étaient couteuses et je n’étais plus assez jeune. Donc j’ai cherché une autre voie, pour faire quelque chose de typiquement français.
Il y avait des débouchés en maroquinerie. Dans ce domaine, il était possible de trouver du travail en France, dans le haut de gamme.
Au début, je n’étais pas enchantée par cette idée, le cuir, ça vient des animaux. Mais, il y a beaucoup de recherches pour des cuirs végétaux, c’est prometteur.
Donc j’ai appris la maroquinerie, en faisant un CAP.
Puis, j’ai cherché du travail en entreprise, mais je crois que mon âge était un problème. J’ai eu des entretiens, cela n’a jamais abouti. Une fois même, j’ai eu plusieurs rendez-vous avec une entreprise en Rhône-Alpes, et à la fin cela n’a pas marché.
Une amie japonaise m’a proposé de venir enseigner à l’Université de Gifu, dans la région de Nagoya. J’y suis restée deux années, je travaillais à la section de la promotion de la diversité, sur l’égalité hommes femmes.

J’en ai profité pour apprendre le travail du cuir à la japonaise, même si mon pays a peu de tradition artisanale dans ce domaine.
Jusqu’au XIXè siècle, il était interdit de tuer les quadrupèdes, ce n’était pas dans notre culture de les manger. La maroquinerie était un métier pour les parias de la société, issus des communautés eta et hinin (les non-humains). Dans leur malheur, ils étaient privilégiés, car ils avaient le droit de récupérer les cadavres des animaux morts naturellement. Il y avait quand même besoin de peaux, surtout pour les armures des samouraïs. Après l’ouverture du pays, il fallait offrir des bottes aux soldats, il y a eu le besoin d’en fabriquer, on a appris mais cela reste récent.
Quand je suis rentrée en France, j’avais plus de quarante cinq ans, j'ai décidé de lancer ma propre marque ATELIER OMORI Je dessine moi-même mes modèles, et je les fabrique ici à l’atelier. Je mélange les techniques traditionnelles de maroquinerie avec d’autres techniques typiquement japonaises, la broderie sashiko par exemple.
J’utilise également l’ise katagami, le pochoir en papier. J’ai appris au lycée, je trouve les différents motifs dans des livres comme celui-ci.
C’est une technique très élaborée, il y a beaucoup à raconter à son sujet. Pendant l’époque d’Edo, il était interdit de porter des vêtements luxueux, les samouraïs ne pouvaient pas mettre de choses colorées. Mais les gens voulaient s’habiller différemment, être chics, alors ils ont inventé le pochoir en papier, avec des motifs très fins et sophistiqués. Aujourd’hui, les artisans traditionnels d’ise katagami sont en train de disparaitre.

J’ai ouvert mon atelier boutique fin 2019. Ici, c’est mon royaume, je m’y sens bien.
Dès le début, il y a eu les grèves puis la crise sanitaire est arrivée.
Ce n’est pas simple dans ce contexte de faire connaître ma marque, je ne sais pas trop comment faire.
Heureusement le local est à mon mari, il n’y a pas de loyer à payer. En ce moment, mes créations sont disponibles à l’atelier Matsuoka dans le quartier des Batignolles à Paris. J’aimerais trouver d’autres points de vente.
J’ai quelques clients fidèles, de la clientèle de quartier pour qui je travaille sur commande. Je peux adapter mes modèles si besoin.
J’ai pensé développer la vente en ligne, mais quand on vend à un certain prix, je crois que les gens préfèrent voir avant d’acheter. C’est ce que mes amis me disent.
Paris est une très belle ville, mais elle n’est pas très propre. Ce mélange de beauté et de saleté, finalement, je l’aime bien. J’apprécie la mentalité des français, ils sont très ouverts, et puis il y a une sorte de melting pot très intéressant. Je suis contente d’échanger avec les clients et d’autres gens, de parler de nos cultures respectives.
Je me sens toujours très japonaise, surtout quand je suis en France. Mais quand je vais dans mon pays, j’ai parfois l’impression d’être une étrangère. Du Japon, c’est la nourriture que me manque le plus, certains poissons, et les poissonneries, il y en a peu à Paris.
Pour l’instant, je n’ai pas prévu de revivre au Japon, peut être quand j’aurai quatre-vingts ans ?
Où, je ne sais pas. Je suis née dans la banlieue de Tokyo, j’y ai toujours vécu, je ne connais pas bien les autres provinces. Il y a beaucoup d’endroits qui m’attirent, surtout les petites villes. J’ai eu l'occasion d’aller pour le travail à Fukuoka sur l’île de Kyūshū. L’alimentation était très bonne, je m’y verrais bien y habiter.
De la France, j’emmènerai beaucoup de choses, ma marque, mes créations et les œuvres de mon mari, ses statues entre autres.
J'ai découvert Naoko sur les réseaux sociaux, elle m'a tout de suite ouvert la porte de son atelier.