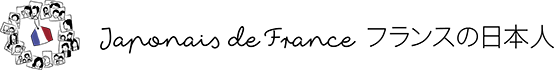Yukimi Yamamoto-Heuzey 山本由紀美・ウゼ
12 avril 2024
Manabu Watanabe 渡辺学
14 juillet 2024J’aime l’esprit français, quelque chose de très vif, avec de la moquerie et beaucoup d’humour
Je m'appelle Yuka, je suis vidéaste et flûtiste de nô. J’ai été formée au théâtre nô enfant, j’ai d’abord appris la musique, puis la danse et le chant.
Ma spécialité, c’est le nôkan, la flûte traditionnelle du théâtre nô, reconnaissable à son timbre très aigu. On l’entend parfois dans les films d’Ozu ou de Kurosawa. Je joue de cette flûte nôkan dans des créations théâtrales franco-japonaises et je participe en tant que vidéaste à différents projets culturels.
J’ai grandi à Tokyo. Mes parents n’avaient pas de lien direct avec le nô, même si ma famille maternelle est de la lignée des O-Tsuzumi de Kyoto, les joueurs de tambour du nô.
Petite, je jouais du piano. Mon professeur était très strict alors à huit ans, j’ai dit à ma mère que je préférais faire de la flûte, pour m’échapper du piano. J’avais en tête la flûte occidentale mais ma mère, avec son histoire familiale, m’a envoyée apprendre le nô. C’est comme ça que j’ai découvert la flûte nôkan et cet univers théâtral dont je ne connaissais en fait rien.
J’ai continué l’étude du nô, et plus tard j’ai été admise à la section musique de nô de l’Université Nationale des Beaux-arts et de la Musique de Tokyo, plus connue sous le nom de Geidai. C’est la seule université du pays où on peut apprendre les arts de la scène traditionnelle japonaise.
La France et moi, c’est grâce au hasard de la vie. Il se trouve que mon meilleur copain à l’université était amoureux de la France. J’étais aussi attirée par la culture européenne, mais plutôt par l’Italie et l’Allemagne. Je l’ai accompagné en cours de français, sans pour autant m’investir vraiment dans l’apprentissage de la langue. Ces leçons ont représenté pour moi une ouverture, loin du Japon très codifié et particulièrement contraignant pour la jeune fille de vingt ans que j’étais.
Un jour, notre professeur de français a pris la direction de la section musique. Il travaillait alors à un projet de jumelage avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Il m’a proposé d’aller en France, me disant « Mademoiselle Toyoshima, vous devriez vous ouvrir au monde. Plutôt que de rester au Japon, allez faire découvrir le théâtre nô aux étrangers ».
Je connaissais Paris, j’y avais logé lors de vacances en Europe avec une copine. Nous étions rue de Montorgueil, je me souviens avoir trouvé la vie colorée… et les rues très sales !
Voilà comment en 1998 j’ai intégré le Conservatoire de Paris en section Musique. Très vite, j’ai demandé à passer dans la section Danse. Il me fallait jouer avec ma flûte nôkan du jazz et de la musique contemporaine, c’était un petit challenge d’interpréter les partitions occidentales avec cet instrument. Je suis restée deux années à Paris puis je suis rentrée au Japon pour terminer mon cursus.
Après l’université, j’ai commencé à travailler chez Uni-France pour la promotion des films français, puis chez Sony Pictures. Je me suis essayée à l'audiovisuel, car avec les nouvelles technologies, on commençait à pouvoir filmer facilement et à monter avec son propre ordinateur.
Je me suis mise à raconter les histoires du nô en image et sans parole, en les interprétant à ma façon, un projet que j’ai appelé HELENA.
Grâce à ça, j’ai reçu une bourse de deux ans du Ministère de la Culture du Japon pour développer en France des projets en relation avec le théâtre contemporain et le nô. J’étais très attirée par le Théâtre du Soleil, j’ai même été parrainée par Ariane Mnouchkine.
Et finalement, je suis restée en France. Entre Japonaises, nous avons une blague : on se dit que « la première année, ce n’est pas facile, la troisième on s’habitue même s'il nous reste des questions, et après sept ans, on ne repart plus ». C’est comme dans un couple en fait !
En parallèle de mes recherches personnelles, j’ai mené des projets multimédias pour des compagnies de spectacle. J’ai réalisé des vidéos pour leurs créations, des captations, et parfois des documentaires pour la télévision et les musées. Ce que je fais encore maintenant.
Le nô est toujours dans ma vie, je continue de participer à des projets qui lui sont liés. Par exemple, j’ai joué l’année dernière dans Medea de la compagnie Sangaku et je participe en ce moment aux résidences de création de la compagnie Théâtre de l’Éventail.
J’aimerais reprendre le fil de mon projet HELENA, donner une forme et un mouvement à mon univers imaginaire inspiré du nô et de la mythologie japonaise. J’ai cette envie de créer quelque chose de moderne dans l’esprit du nô, que ce soit un film ou de la scène.
Il existe beaucoup de pièces de “nô contemporain” mais pour moi, cela reste des histoires actuelles racontées dans la forme traditionnelle. J’imagine que si Zeami, le père du nô, était né dans notre monde, il aurait créé le nô tout autrement, gardant son esprit originel mais utilisant les moyens dont nous disposons aujourd’hui.
Ce que je trouve extraordinaire dans le nô, c'est son essence, son esthétique et son dynamisme musical. Des choses qui se retrouvent d’ailleurs dans d’autres arts classiques japonais. J’ai toujours été charmée par l’âme du nô, et c’est elle qu’il m’importe de partager. Mais dans un format différent, qui me serait propre.
Quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas vraiment la langue. Mais j’avais tellement envie de m’exprimer, de participer aux discussions que je m’y suis mise.
Il y a dans ce pays une sensibilité intellectuelle que j’admire, elle se retrouve dans un raffinement artistique très différent de celui du Japon. Et puis j’aime l’esprit français, quelque chose de très vif, avec de la moquerie et beaucoup d’humour. Même si ça râle beaucoup.
A Paris, je sens la liberté, je fais ce que je veux de ma vie et de mon temps. Quand je travaillais chez Sony Pictures, je pensais que les choses seraient plus faciles, étant une entreprise nippo-américaine. Je me trompais. Un jour que j’avais terminé mon travail plus tôt, j’avais demandé à mon supérieur l’autorisation de m’en aller. Le refus avait été formel, il me fallait rester, quitte à lire un bouquin. Étant la dernière arrivée dans l’entreprise, je devais attendre que les autres partent pour pouvoir partir à mon tour. Je n’ai jamais compris ce code social qui fait perdre du temps pour rien !
Au Japon, on grandit dans l’attention à l’autre, beaucoup de choses ne sont pas exprimées, il faut savoir décrypter les non-dits. Tandis qu’en France, on est plus direct. Je trouve qu’il manque parfois de la tendresse envers les autres et du respect de la communauté.
Les Japonais que je rencontre me disent que je ne suis pas Japonaise, alors que je me sens toujours Japonaise, une Japonaise atypique, certes, mais quand même. Quand viendra mon dernier souffle de vie, c’est l’odeur de la soupe miso qui me restera, pas celle du fromage !
C’est d’ailleurs la nourriture qui me manque le plus de mon pays, ici ça n’a pas le même goût. Cela ne s’explique pas. Et puis, il y a l’air, l’atmosphère. Je sens ce changement dès que je pose le pied à l’aéroport de Narita. Quelque chose de l’ordre du sacré, une perception subtile de la nature, qui est là en moi depuis toujours. Parce que je suis japonaise. Et cela n’a rien à voir avec un quelconque sentiment de chauvinisme.
J’essaie d’aller au Japon le plus souvent possible pour voir ma mère qui est seule. Sans elle, je n’aurais plus de raison d’y retourner. J’ai passé la moitié de ma vie en France, mes amis et ma vie sont désormais ici. Le nô est en moi, je vis avec lui, à ma façon, en France.